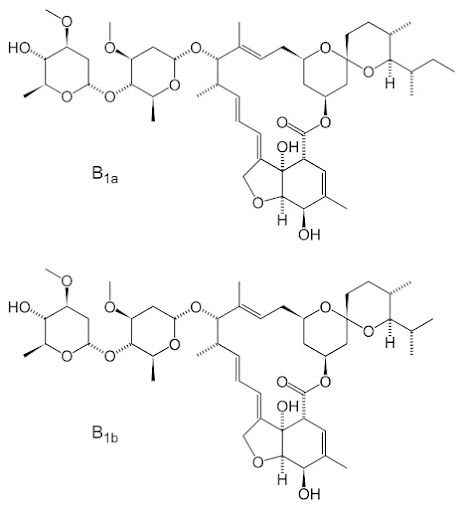La presse nous mène à la guerre nucléaire ; occasion de relire notre texte sur Serge Halimi : les nouveaux chiens de garde et le passe sanitaire. Qu’il s’agisse de l’Europe, du vaccin, de la haine de Trump, de Musk ou Carlson, de la France (encore) patriote ou de la Russie, des éoliennes ou des caisses électriques, des minorités et de la grande invasion, de Gaza ou de l’Irak, la presse a toujours été la hauteur. Et elle le sera toujours, subventionnée ou pas. Ce cauchemar dure depuis des siècles, disons-le nûment. Question : depuis 1981 (arrivée de « la gauche au pouvoir ») ou 1870 ? Ou depuis 1789 ou – mettons – 1715 ? Parce que quand on la relit la « littérature » du siècle dit des Lumières…
La presse française, qui appartient à quelques oligarques (dont Bernard LVMH, qui pèse aujourd’hui MILLE milliards…de francs) et est subventionnée à hauteur de 500 millions d’euros tant elle dégoûte les Français, aura été crasse et ignoble depuis le début de cette histoire : affolement, confinements, masques, vaccins, meurtres de masse, passes sanitaires, chantage et menaces, elle nous aura tout imposé. Malheureusement il n’y a rien de nouveau sous le sommeil : depuis les années Mitterrand et le passage du col Mao au Rotary (Hocquenghem) nous sommes dans un présent permanent d’omerta (Coignard), d’abjection et de désinformation. Nous sommes là pour enrichir les riches et pour empoisonner les Français, disent les gardiens de camp médiatique et électronique.
C’est que les gens dont nous parlons sont des chiens de garde. Et quels dobermans ! Et quels roquets ! Revenons-en alors au maître-livre de Serge Halimi, trublion du Monde diplomatique, qui rappelait dans son très documenté pamphlet que le journaliste est avant tout un enthousiaste :
« La censure est cependant plus efficace quand elle n’a pas besoin de se dire, quand les intérêts du patron miraculeusement coïncident avec ceux de « l’information ». Le journaliste est alors prodigieusement libre. Et il est heureux. On lui octroie en prime le droit de se croire puissant. Fêtard sur la brèche d’un mur de Berlin qui s’ouvre à la liberté et au marché, petit soldat ébloui par l’armada de l’OTAN héliportant au Kosovo la guerre « chirurgicale » et les croisés de l’Occident, avocat quotidien de l’Europe libérale au moment du référendum constitutionnel : reporters et commentateurs eurent alors carte blanche pour exprimer leur enthousiasme. Le monde avait basculé dans la « société de l’information », avec ses hiérarchies « en réseau », ses blogs et ses nouveaux seigneurs. »
La presse fut chargée d’encenser Davos :
« Le capitalisme a ses charités, ses philanthropes dont la mission est d’enjoliver un système peu amène envers ceux qu’il ne comble pas de ses bienfaits. La presse trône au premier plan de ces campagnes de blanchiment. Ainsi, Davos, autrefois conclave des « global leaders » soucieux de « créer de la valeur » pour leurs actionnaires, serait presque devenu un lieu de virée pour patrons copains et citoyens. »
Halimi tacle au passage l’effarant Joffrin :
« N’accablons pas Laurent Joffrin. Lui qui, pendant les années Reagan, célébra les États- Unis et le libéralisme (l’émission « Vive la crise ! » fut en partie son œuvre) n’a fait que traduire à sa modeste échelle ce que, sous la double pression de la concentration capitaliste et d’une concurrence commerciale favorisant le conformisme et la bêtise, le journalisme est devenu presque partout : creux et révérencieux. »
La géographie ça sert d’abord à faire la guerre, disait Yves Lacoste. La presse encore plus, surtout dans une puissance belligène et coloniale :
« Pendant les guerres, la presse se soucie moins de consensus, de pédagogie, de complexité, et davantage de réchauffer l’ardeur des combattants. Presque tout a été dit sur l’effondrement de l’esprit critique lors de la guerre du Golfe où, mis à part L’Humanité et La Croix (par intermittence), chacun des directeurs de quotidien se plaça au service de nos soldats. Quasiment unanimes, les hebdos, radios et télévisions firent chorus, se transformant en classe de recyclage pour officier au rancart vaincu en Algérie trente ans plus tôt et soucieux de prendre, dans les médias, sa revanche sur les Arabes. »
Halimi souligne cette haine pathologique du peuple. On la sentit venir en 1992 au moment de Maastricht. Juste là confinée au nationaliste pauvre (raciste, fasciste, nazi, antisémite, etc.), cette haine se communiqua à tout le peuple de gauche, du centre ou d’ailleurs :
« En 1992, la campagne du référendum sur le traité de Maastricht répéta les « dérives » observées pendant la guerre du Golfe. Là encore, beaucoup de choses se conjuguèrent : la volonté d’encourager l’élite éclairée qui construit l’avenir (« l’Europe») alors que le peuple ne sait qu’exhaler ses nostalgies, sa « xénophobie » et ses « peurs » ; la préférence instinctive pour les options du centre, surtout lorsqu’elles s’opposent aux extrêmes « populiste » et « nationaliste » ; enfin la place accordée aux avis des experts et des intellectuels, eux aussi particulièrement sensibles aux ressorts précédents. Intelligence contre irrationalité, ouverture contre repli, avenir contre passé, ordre contre meute : tous ces fragments d’un discours méprisant de caste et de classe resurgirent au moment du référendum de mai 2005 sur le traité constitutionnel européen. »
Et comme on continue de chercher la petite bête immonde ici et ailleurs, Halimi rappelle :
« Il a fallu attendre la fin du second septennat de François Mitterrand pour découvrir que l’ancien président de la République avait, sciemment et longtemps après la guerre, continué à fréquenter un haut dignitaire de Vichy impliqué dans les basses œuvres de ce régime, qu’il avait envoyé à la guillotine des militants de l’indépendance algérienne…Tant d’enquêteurs et tant de journaux se prétendant concurrents pour arriver à ce résultat-là ! »
Ce qui est juif, disait Goebbels à Fritz Lang, nous en décidons. Ce qui est antisémite aussi.
Concluons philosophiquement comme l’andouille Ferry. La presse française est crevée depuis longtemps. Comme l’église ou les partis, elle survit en hystérésis, grâce à nos subventions.
Nicolas Bonnal