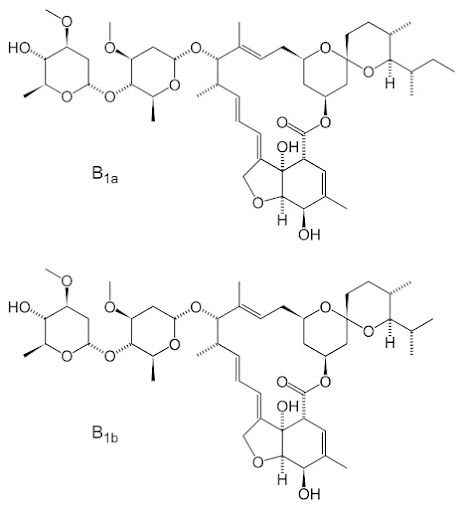Il ne fallait pas être sorti de Saint-Cyr ou de Polytechnique, voire de l’ENA, pour comprendre que le renouvellement du bail d’Elisabeth Borne à Matignon, il y a cinq mois et demi, relevait davantage du contrat à durée déterminée que du contrat à durée indéterminée. Aussi avais-je cru bon de mettre un point d’interrogation au titre de ma tribune du 21 juillet : « Elisabeth 2, reine de Matignon ? ».
Puisque nous sommes dans le registre du Code du travail, constatons qu’Elisabeth Borne vient de faire l’objet d’un licenciement sans préavis formel, avec cependant les indemnités et avantages dus aux anciens Premiers ministres.
Sa lettre au président de la République est dénuée de toute ambiguïté. Elle se voyait bien poursuivre sa tâche à l’hôtel de Matignon, après avoir fait passer au forceps la loi immigration, même si l’épisode qui a provoqué l’éclatement du groupe macroniste à l’Assemblée nationale ne sera pas sans conséquences. Le « Vous m’avez fait part de votre volonté de nommer un nouveau Premier ministre », comme le « Il me faut présenter la démission de mon gouvernement » ne sont certainement pas les mots d’un chef de gouvernement qui s’attendait à être limogé, même avec les remerciements d’usage.
En délicatesse avec les Françaises et les Français, comme les enquêtes d’opinion l’attestent très régulièrement, M. Macron fait le pari qu’il pourra récupérer une partie de la popularité du plus jeune Premier ministre qu’il donne à la France. « En même temps », pour parler comme lui, il tente de mettre en piste un candidat pour sa succession. Il est, bien sûr, trop tôt pour savoir si M. Attal sera en mesure de disputer avec quelques chances de succès l’épreuve présidentielle de 2027 (j’écris cela en pensant au président sportif qui est à l’Élysée !). Mais il convient de se rappeler qu’en 65 ans de Ve République, le passage par Matignon n’a jamais semblé aux Français une figure imposée pour occuper la fonction suprême.
A l’insu de son plein gré
Le départ de Madame Borne, « à l’insu de son plein gré » comme le disait un vrai sportif de haut niveau, ne manque cependant pas de soulever une question à laquelle il faudra bien un jour apporter une réponse. C’est celle de la Constitution et de son article 8, rédigé de la sorte : « Le président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement ».
L’hypothèse ne s’est jamais présentée, mais elle existe en théorie : un Premier ministre qui refuserait de présenter la démission du gouvernement, et entendrait se maintenir en fonction. Interrogé à ce sujet en 1972, Jacques Chaban-Delmas — Premier ministre à qui Georges Pompidou, président de la République, venait de signifier son congé — avait répondu que le Premier ministre qui refuserait de démissionner à la demande du chef de l’Etat (et non de sa propre initiative, comme le fit plus tard Jacques Chirac sous Valéry Giscard d’Estaing) serait « un triste sire ».
En attendant, triste sire ou pas, mieux vaudrait que le libellé du parchemin rejoigne la longue pratique de la Ve République, mi-présidentielle, mi-parlementaire. C’était déjà l’opinion de son fondateur, rapportée par Alain Peyrefitte dans C’était de Gaulle. Lors d’une conversation, le général de Gaulle avait confié à son ministre qu’il conviendrait, sur ce point, de procéder à une révision de la Constitution. L’article 8 pourrait par exemple être écrit simplement ainsi : « Le président de la République nomme et révoque le Premier ministre ».
Ce serait à l’évidence plus conforme à la réalité, et tout autant à l’esprit du régime : si le président de la République est l’élu du peuple français, le Premier ministre est choisi et nommé par le président de la République. Hormis les périodes de cohabitation, il est son second.
Alain Tranchant est ancien délégué départemental de mouvements gaullistes en Vendée et Loire-Atlantique et président-fondateur de l’Association pour un référendum sur la loi électorale.