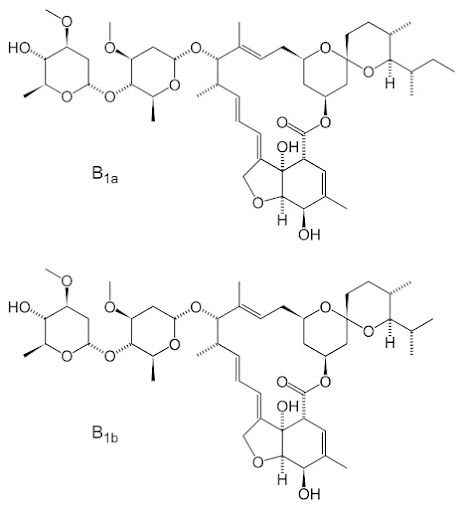Il faudra plus que de la honte pour que la génération censurée comprenne son propre vide agressif.
Par Thomas Buckley.
Ce sont ces sentiments – parmi d’autres – qui décrivent la réaction générale aux révélations des Twitter Files et à d’autres épisodes flagrants de censure sur les réseaux sociaux par les Big Tech.
L’accord implicite avec des entreprises comme Twitter, Facebook, Google, etc. est très simple : nous regarderons vos publicités si vous nous offrez un service gratuit. L’accord n’incluait pas la censure.
Mais à quoi la société doit-elle s’attendre lorsque les censeurs semblent n’y voir absolument rien de mal et qu’il ne leur est même pas venu à l’esprit que ce qu’ils faisaient – souvent à la demande expresse d’agences gouvernementales – posait le moindre problème ?
Pour une génération qui a grandi avec les codes, les convenances imposées, la déférence automatique pour les sentiments d’autrui, et qui a été emmaillotée dans du papier bulle contre les aléas de la vie, la limite de la liberté d’expression n’est certainement pas un saut éthique, mais c’est la bonne chose à faire.
Si l’on ajoute à cela une auto-infantilisation permanente et délibérée qui les pousse à s’en remettre à toute personne qu’ils perçoivent comme adulte (ou à s’énerver de manière incohérente parce qu’elle n’a pas censuré le discours), comme l’ancien gros bonnet du FBI James Baker sur Twitter, le décor est non seulement planté, mais la fin terrifiante de la pièce s’écrit d’elle-même.
Cette génération ne sont pas nécessairement les générations Y, X, ou les millénials – il s’agit de personnes âgées d’environ 16 à 36 ans, des chiffres qui, malheureusement, deviendront probablement de plus en plus importants au fur et à mesure que le temps passe.
Il s’agit d’une sous-cohorte (j’ai pensé qu’il valait mieux apprendre leur langue) de personnes qui ont beaucoup en commun : tout d’abord, elles sont issues de familles plus petites, ce qui est désormais la règle et n’ont donc pas la peau épaisse et les compétences acquises lorsque l’on a des frères et sœurs.
Elles ont généralement grandi dans une relative aisance et ne sont pas à l’aise avec la confrontation. Elles ont fréquenté les bonnes écoles mais ne comprennent pas que d’autres puissent penser différemment. Elles sont surdiplômées mais en réalité largement sous-éduquées. Elles éprouvent un sentiment de culpabilité lorsque l’épicerie effectue des livraisons, mais sont convaincues qu’un trajet de 25 minutes jusqu’à l’épicerie est une perte de temps précieux.
Bien que les exemples soient très nombreux, deux événements émergent comme des moments exemplaires pour la génération censurée. Tout d’abord, cet incident plutôt bien connu de l’université de Yale, dans lequel un étudiant exige d’être traité comme un enfant, et cette histoire glaçante d’un professeur luttant contre les « meilleurs et les plus brillants » qui demandent à être sermonnés plutôt que de participer à un séminaire.
Le professeur Vincent Lloyd, directeur des études noires à l’université de Villanova, écrit :
« Comme d’autres personnes de gauche, j’avais rejeté les critiques du discours actuel sur la race aux États-Unis. Mais mes pensées se tournent maintenant vers les années 1970 où les organisations de gauche ont implosé, la nécessité de s’aligner sur le militantisme de ses camarades conduisant à une culture toxique remplie de dogmatisme et de désillusion. Comment cela a-t-il pu arriver à un groupe de lycéens brillants ? »
Ce souvenir du passé, pour ainsi dire, ne doit pas être considéré comme une angoisse générationnelle de type « Touche pas à mes fesses ». Lorsqu’on critique le déhanchement d’Elvis Presley, il ne s’agit pas d’effacer de sa mémoire tous ces sous-vêtements apparaissant lors d’un boogie woogie des années 1940.
Ces deux exemples montrent clairement qu’un changement radical s’est produit au cours des dix ou quinze dernières années. Il est tout simplement inimaginable que les étudiants d’alors aient exigé davantage de limites, de restrictions, de sermonts, qu’on leur dise ce qu’ils doivent penser et surtout comment ils doivent penser.
Cela ne s’est jamais produit auparavant
Cette « agonie doctrinale sur les symboles », pour citer le livre d’Alan Furst Le correspondant étranger, a toujours existé mais elle ne s’épanouissait que dans des environnements monomaniaques isolés, comme les cloîtres d’un monastère médiéval ou une arrière-salle miteuse remplie de bolcheviks qui se chamaillent. Aujourd’hui, ces querelles vides de sens captent une grande partie de l’attention du monde et impliquent une course au bout du dogme, à un purgatoire de pureté qui, grâce à la vitesse des médias sociaux, nous a tous engloutis.
Le passé a connu son lot équivalent d’événements et de tendances, mais la vitesse à laquelle les « faits », les pensées et les concepts circulent sur l’internet détruit essentiellement les garde-fous habituels contre les mauvaises idées, à savoir la nuance, l’histoire, la recherche, la raison, le temps de réflexion, les sources fiables et le contexte adéquat. Cela a permis aux gens d’ignorer ou de rejeter tout ce qu’ils pensaient être en contradiction avec leurs propres idées et les idées à la mode à ce moment-là. C’est cet état permanent de flux, intentionnellement détaché du passé néfaste et de ses attentes, qui permet à l’impensable non seulement d’être pensé mais aussi d’être mis en œuvre.
Et parce que c’est le seul monde – un monde de destruction nonchalante – que la génération censurée ait jamais connu, il est tout à fait naturel qu’elle soit si terrifiée à l’idée de dire ce qu’il ne faut pas, de faire ce qu’il ne faut pas, de s’écarter trop du diktat du jour, qu’elle ne peut pas saisir l’énormité de ses actes.
Yeonmi Park, cette jeune femme réfugiée de Corée du Nord, s’est étonnée lors de son passage à l’université de Columbia : « J’ai réalisé que c’était de la folie. Je pensais que l’Amérique était différente mais j’ai constaté tellement de similitudes avec ce que j’ai vécu en Corée du Nord que j’ai commencé à m’inquiéter ». C’est un avertissement qui devrait être pris en compte mais qui ne l’a pas été. C’est l’ultime outsider qui remarque ce que les autres ne peuvent ou ne veulent pas faire, et c’est dérangeant au plus haut point. Ou du moins, cela le serait si ce n’était pas si peu surprenant.
Cet abandon par les prétendus progressistes du principe le plus important – tous peuvent parler, tous peuvent être entendus, et vous pouvez décider d’écouter ou non – commence à lasser même les plus anciens de la gauche modérée. Joyce Carol Oates a déclenché une tempête sur Twitter – bien sûr, soupir – lorsqu’elle a critiqué l’annonce récente de la réédition posthume de l’œuvre de Roald Dahl par des lecteurs émotifs engagés par la maison d’édition.
Pour sa part, Richard Dawkins – qui n’est pas un conservateur patenté – a récemment déclaré, lorsqu’on l’a interrogé sur la proposition d’éliminer l’utilisation de mots tels que « homme » ou « femme » dans les articles scientifiques : « Je ne vais pas me laisser imposer par une version adolescente de Mme Grundy quels mots de ma langue maternelle je peux ou ne peux pas utiliser ».
Mais il faudra plus que de la honte pour que la génération censurée comprenne son propre vide agressif. Ce n’est que lorsque le système qui l’a créée, qui l’a validée et qui l’emploie aujourd’hui changera lui-même qu’elle pourra se considérer différemment, au même titre qu’un individu discret capable de liberté de pensée et capable de permettre aux autres de jouir de ce même droit fondamental.
Et ces systèmes – éducatif, gouvernemental, financier, social, culturel – n’ont aucune raison de changer.
Pour l’instant.
—
Source :